Livres
 La Direction des Services automobiles des armées et la motorisation des
armées françaises (1914-1918), vues à travers l’action du commandant Doumenc
La Direction des Services automobiles des armées et la motorisation des
armées françaises (1914-1918), vues à travers l’action du commandant Doumenc
Lavauzelle, Panazol, 2004.
A partir de ma thèse de doctorat, la première étude d’ensemble sur la motorisation des armées pendant la Première Guerre mondiale, sous l’angle du service automobile du GQG, dans les domaines de
l’organisation, de la gestion et de l’emploi, des ‘Taxis de la Marne’ aux offensives de l’automne 1918, en passant par la ‘Voie sacrée’ et la Somme.
La mobilisation industrielle, ‘premier
front’ de la Grande Guerre ? 
14/18 Editions, Saint-Cloud, 2005 (préface du professeur Jean-Jacques Becker).
En 302 pages (+ 42 pages d’annexes et de bibliographie), toute l’évolution industrielle de l’intérieur pendant la Première Guerre mondiale. Afin de produire toujours davantage pour les armées en
campagne, l’organisation complète de la nation, dans tous les secteurs économiques et industriels. Accompagné de nombreux tableaux de synthèse.
 La conquête des colonies allemandes. Naissance
et mort d’un rêve impérial
La conquête des colonies allemandes. Naissance
et mort d’un rêve impérial
14/18 Editions, Saint-Cloud, 2006 (préface du professeur Jacques Frémeaux).
Au début de la Grande Guerre, l’empire colonial allemand est de création récente. Sans continuité territoriale, les différents territoires ultramarins du Reich sont difficilement
défendables. De sa constitution à la fin du XIXe siècle à sa dévolution après le traité de Versailles, toutes les étapes de sa conquête entre 1914 et 1918 (388 pages, + 11 pages
d’annexes, 15 pages de bibliographie, index et cartes).
 Du Caire à Damas. Français et Anglais au Proche-Orient (1914-1919)
Du Caire à Damas. Français et Anglais au Proche-Orient (1914-1919)
14/18 Editions, Saint-Cloud, 2008 (préface du professeur Jean-Charles Jauffret).
Du premier au dernier jour de la Grande Guerre, bien que la priorité soit accordée au front de France, Paris entretient en Orient plusieurs missions qui participent, avec les nombreux contingents
britanniques, aux opérations du Sinaï, d’Arabie, de Palestine et de Syrie. Mais, dans ce cadre géographique, les oppositions diplomatiques entre ‘alliés’ sont au moins aussi importantes que les
campagnes militaires elles-mêmes.
 Haute-Silésie (1920-1922). Laboratoire des ‘leçons oubliées’ de l’armée française et perceptions
nationales
Haute-Silésie (1920-1922). Laboratoire des ‘leçons oubliées’ de l’armée française et perceptions
nationales
‘Etudes académiques », Riveneuve Editions, Paris, 2009.
Première étude d’ensemble en français sur la question, à partir du volume de mon habilitation à diriger des recherches. Le récit détaillé de la première opération civilo-militaire moderne
d’interposition entre des factions en lutte (Allemands et Polonais) conduite par une coalition internationale (France, Grande-Bretagne, Italie), à partir des archives françaises et étrangères et
de la presse de l’époque (381 pages + 53 pages d’annexes, index et bibliographie).
 Le commandement suprême de l’armée allemande 1914-1916, édition annotée et commentée des souvenirs de guerre du
général von Falkenhayn
Le commandement suprême de l’armée allemande 1914-1916, édition annotée et commentée des souvenirs de guerre du
général von Falkenhayn
14/18 Editions - SOTECA, Saint-Cloud, 2010.
Le texte original de l’édition française de 1921 des mémoires de l’ancien chef d’état-major général allemand, accompagné d’un dispositif complet de notes infrapaginales permettant de situer les
lieux, de rappeler la carrière des personnages cités et surtout de comparer ses affirmations avec les documents d’archives et les témoignages des autres acteurs (339 pages + 34 pages d’annexes,
cartes et index).
 Chronologie commentée de la Première Guerre mondiale
Chronologie commentée de la Première Guerre mondiale
Perrin, Paris, 2011.
La Grande Guerre au jour le jour entre juin 1914 et juin 1919, dans tous les domaines (militaire, mais aussi politique, diplomatique, économique, financier, social, culturel) et sur tous les
fronts. Environ 15.000 événements sur 607 pages (+ 36 pages de bibliographie et d’index).
Les secrets de la Grande Guerre
Librairie Vuibert, Paris, 2012.
Un volume grand public permettant, à partir d’une vingtaine de situations personnelles ou d’exemples concrets, de remettre en lumière quelques épisodes peu connus de la Première Guerre mondiale,
de la question du « pantalon rouge » en août 1914 à l’acceptation de l’armistice par von Lettow-Vorbeck en Afrique orientale, après la fin des hostilités sur le théâtre ouest-européen.
 Mon commandement en Orient, édition annotée et commentée des souvenirs de guerre du
général Sarrail
Mon commandement en Orient, édition annotée et commentée des souvenirs de guerre du
général Sarrail
14/18 Editions - SOTECA, Saint-Cloud, 2012
Le texte intégral de l'édition originale, passé au crible des archives publiques, des fonds privés et des témoignages des acteurs. Le récit fait par Sarrail de son temps de commandement à
Salonique (1915-1917) apparaît véritablement comme un exemple presque caricatural de mémoires d'autojustification a posteriori.
Coordination et direction d’ouvrages
Destins d’exception. Les parrains de promotion de
l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr
SHAT, Vincennes, 2002.
Présentation (très largement illustrée, 139 pages) des 58 parrains qui ont donné leur nom à des promotions de Saint-Cyr, entre la promotion « du Prince Impérial » (1857-1858) et la
promotion « chef d’escadrons Raffalli » (1998-2001).
 La France Libre. L’épopée des Français Libres au combat, 1940-1945
La France Libre. L’épopée des Français Libres au combat, 1940-1945
SHAT, Vincennes et LBM, Paris, 2004.
Album illustré présentant en 191 pages l’histoire et les parcours (individuels et collectifs) des volontaires de la France Libre pendant la Seconde guerre mondiale.
 La marque du courage
La marque du courage
SHD, Vincennes et LBM, Paris, 2005.
Album illustré présentant en 189 pages l’histoire des Croix de Guerre et de la Valeur Militaire, à travers une succession de portraits, de la Première Guerre mondiale à la Bosnie en 1995. L’album
comporte en annexe une étude sur la symbolique, les fourragères et la liste des unités d’active décorées.
90e anniversaire de la Croix de
guerre
SHD, Vincennes, 2006.
Actes de la journée d’études tenue au Musée de l’Armée le 16 novembre 2005. Douze contributions d’officiers historiens et d’universitaires, français et étrangers, de la naissance de la Croix de
guerre à sa perception dans la société française, en passant les décorations alliées similaires et ses évolutions ultérieures.
 Les relations militaires franco-grecques. De la Restauration à la Seconde guerre
mondiale
Les relations militaires franco-grecques. De la Restauration à la Seconde guerre
mondiale
SHD,Vincennes, 2007.
Durant cette période, les relations militaires franco-grecques ont été particulièrement intenses, portées à la fois par les sentiments philhellènes qui se développent dans l’hexagone (la France
est l’une des ‘Puissances protectrices’ dès la renaissance du pays) et par la volonté de ne pas céder d’influence aux Anglais, aux Allemands ou aux Italiens. La campagne de Morée en 1828,
l’intervention en Crète en 1897, les opérations en Russie du Sud en 1919 constituent quelques uns des onze chapitres de ce volume, complété par un inventaire exhaustif des
fonds conservés à Vincennes.
 Les 300 jours de Verdun
Les 300 jours de Verdun
Editions Italiques, Triel-sur-Seine, 2006 (Jean-Pierre Turbergue, Dir.).
Exceptionnel album de 550 pages, très richement illustré, réalisé en partenariat entre les éditions Italiques et le Service historique de la Défense. Toutes les opérations sur le front de Verdun
en 1916 au jour le jour.
 Dictionnaire de la Grande Guerre
Dictionnaire de la Grande Guerre
(avec François Cochet), 'Bouquins', R. Laffont, 2008.
Une cinquantaine de contributeurs parmi les meilleurs spécialistes de la Grande Guerre, 1.100 pages, 2.500 entrées : toute la Première Guerre mondiale de A à Z, les hommes, les lieux, les
matériels, les opérations, les règlements, les doctrines, etc.
 Ferdinand Foch (1851-1929). Apprenez à penser
Ferdinand Foch (1851-1929). Apprenez à penser
(avec François Cochet), 14/18 Editions - SOTECA, Saint-Cloud, 2010.
Actes du colloque international tenu à l’Ecole militaire les 6 et 7 novembre 2008. Vingt-quatre communications balayant tous les aspects de la carrière du maréchal Foch, de sa formation à son
héritage dans les armées alliées par des historiens, civils et militaires, de neuf nations (461 pages + 16 pages de bibliographie).







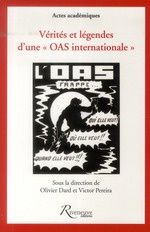

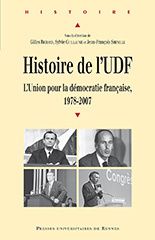
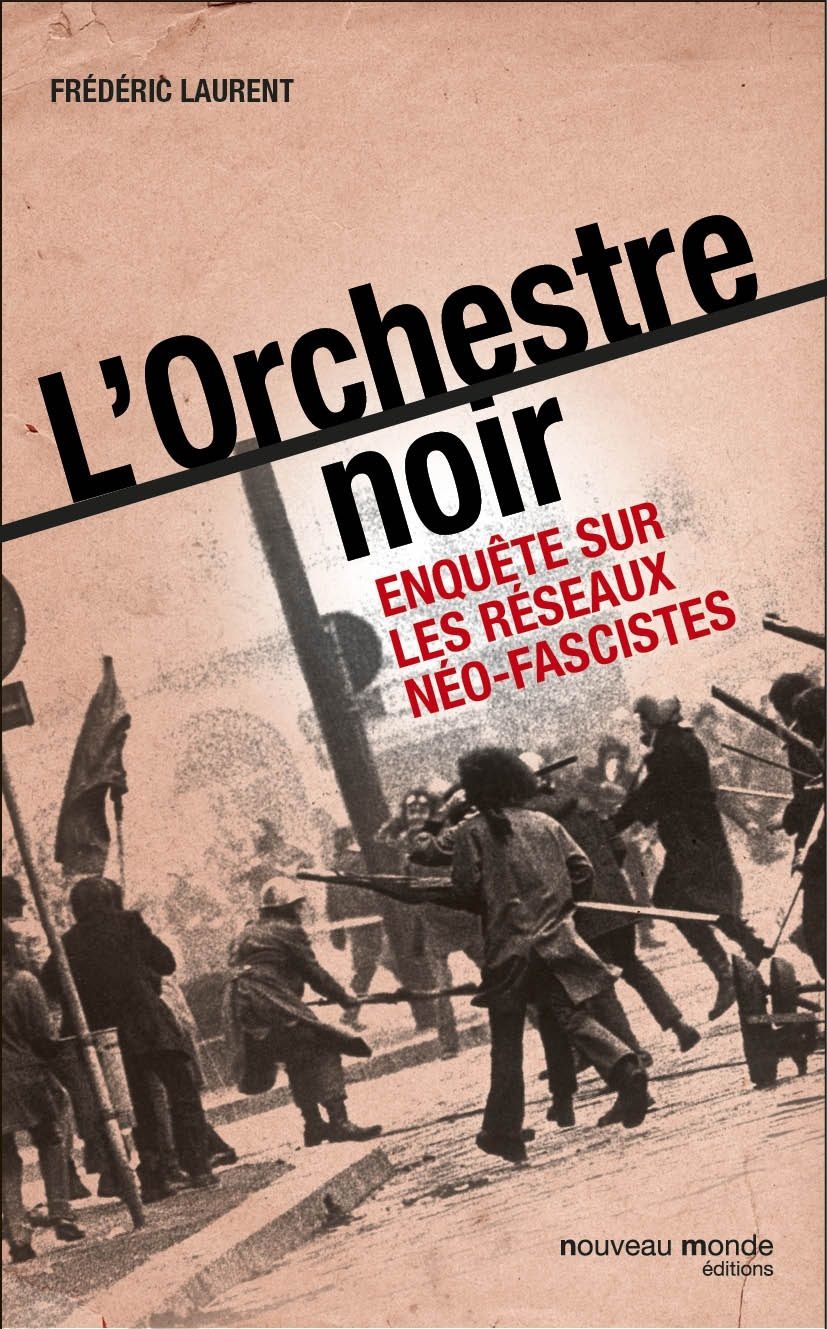

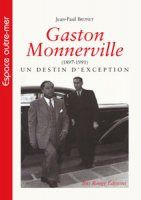


 La Direction des Services automobiles des armées et la motorisation des
armées françaises (1914-1918), vues à travers l’action du commandant Doumenc
La Direction des Services automobiles des armées et la motorisation des
armées françaises (1914-1918), vues à travers l’action du commandant Doumenc

 Du Caire à Damas. Français et Anglais au Proche-Orient (1914-1919)
Du Caire à Damas. Français et Anglais au Proche-Orient (1914-1919)



 Mon commandement en Orient, édition annotée et commentée des souvenirs de guerre du
général Sarrail
Mon commandement en Orient, édition annotée et commentée des souvenirs de guerre du
général Sarrail




 Dictionnaire de la Grande Guerre
Dictionnaire de la Grande Guerre